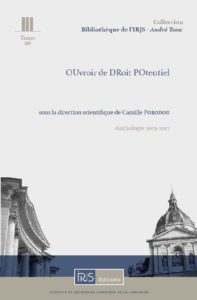Créé en 1960, l’Oulipo a notamment été inspiré à ses fondateurs, Queneau et Le Lionnais, par l’expérience de deux poètes emprisonnés pendant la Seconde guerre mondiale. L’un sans crayon en apprenant ses poèmes par cœur, l’autre sans véritable papier, ils ont tenu grâce à leurs inventions poétiques. Toute proportion gardée, nous avons « tenu » pendant l’épisode de la pandémie ayant vu le droit bien maltraité en maintenant nos ateliers oudropiens en visioconférence et en imaginant nos 101 contraintes. Il s’agit de contraintes visibles visant à se libérer de certaines emprises invisibles (des préjugés, des a priori, des schémas de pensée pris pour naturel) pour pratiquer et créer du droit potentiel.
Il va de soi que l’application d’une contrainte se fait en toute liberté.
Avertissement : en hommage au roman « La disparition » de Perec, une lettre ne donne pas lieu à une contrainte. Il s’agit du X si souvent utilisé pourtant par les procédés de pseudonymisation.